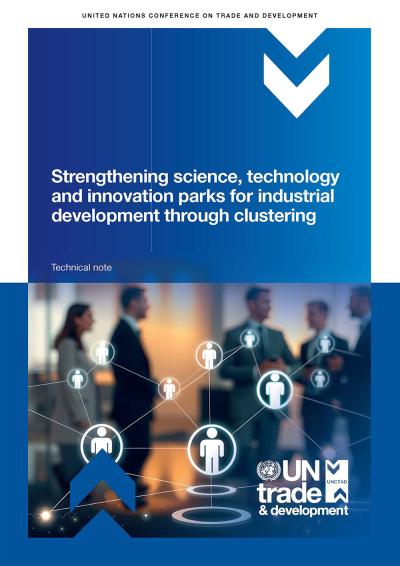
Les parcs scientifiques, technologiques et d’innovation (STI) sont des espaces désignés qui favorisent l’innovation, le développement technologique et la croissance économique en concentrant des ressources, des expertises et des infrastructures pour promouvoir l’innovation.
En réunissant dans une même zone géographique, qui offre un écosystème volontairement collaboratif, un ensemble d’universités, d’institutions de recherche, d’entreprises technologiques, d’entités gouvernementales, d’incubateurs et d’accélérateurs ainsi que des acteurs industriels, les parcs STI jouent un rôle essentiel dans l’appui aux systèmes nationaux d’innovation en comblant les écarts technologiques et industriels, en renforçant la compétitivité et en facilitant le développement durable.
La concentration est une caractéristique fondamentale des parcs STI. Elle désigne l’agglomération spatiale et fonctionnelle d’entreprises interconnectées, d’organismes de recherche et de prestataires de services qui collaborent pour renforcer la productivité, l’innovation et la compétitivité.
En termes simples, cela signifie implanter de manière stratégique des entités similaires ou complémentaires à proximité les unes des autres afin de créer un écosystème dynamique qui maximise la collaboration, l’innovation et le développement économique régional par le progrès technologique. Ce phénomène, ancré dans le concept d’économies d’agglomération d’Alfred Marshall, s’appuie sur la proximité pour générer des économies d’échelle, des externalités de connaissance et des liens interentreprises, souvent désignés sous le nom de « Trinité de Marshall ».
Au sein des parcs STI, la concentration vise à créer un environnement synergique où la proximité ; le partage de ressources, de services, d’installations et d’équipements ; l’accès aux talents et aux expertises ainsi que les réseaux de collaboration s’associent pour ouvrir des voies de commercialisation à de nouvelles technologies, générer de nouveaux droits de propriété intellectuelle et des initiatives entrepreneuriales, offrir des programmes d’incubation, du mentorat et du coaching pour soutenir la réussite des jeunes pousses et entreprises issues des parcs, et renforcer l’innovation.
Les parcs STI servent de versions contemporaines des grappes industrielles pour stimuler le développement industriel. En favorisant la co-localisation thématique et l’intégration des chaînes de valeur, ces parcs créent des environnements où l’innovation peut s’épanouir, permettant ainsi aux régions de concurrencer efficacement dans l’économie mondiale fondée sur la connaissance.
Au sein des parcs STI, la concentration facilite également une intégration plus poussée dans les chaînes de valeur industrielles, aidant les entreprises, en particulier les petites et moyennes entreprises (PME), à surmonter les défis liés aux contraintes de ressources, à l’accès aux marchés et aux capacités technologiques.
Grâce à la concentration, les parcs STI offrent une plateforme d’action collective, de services à valeur ajoutée, d’infrastructures spécialisées et d’interventions politiques ciblées, créant ainsi des conditions favorables à l’entrepreneuriat, à l’innovation et au développement durable.
La présente note technique met en lumière le potentiel transformateur des parcs STI lorsqu’ils sont conçus et gérés de manière efficace.
Alors que les pays en développement font face à des bouleversements technologiques et à des pressions concurrentielles, la concentration au sein des parcs STI constitue une voie éprouvée vers une croissance fondée sur l’innovation, à condition que les parties prenantes agissent de manière décisive pour créer des environnements propices.
S’appuyant sur les travaux analytiques existants et les bonnes pratiques, elle fournit des orientations fondées sur des données probantes à l’intention des décideurs, des aménageurs régionaux et des acteurs des écosystèmes d’innovation.
La note technique a été élaborée dans le cadre du projet de la CNUCED « Parcs scientifiques, technologiques et d’innovation au service du développement durable : Renforcer l’expertise en politique et en pratique dans certains pays d’Asie et d’Afrique », financé par le sous-fonds pour le Programme de développement durable à l’horizon 2030 relevant du Fonds des Nations Unies pour la paix et le développement.


